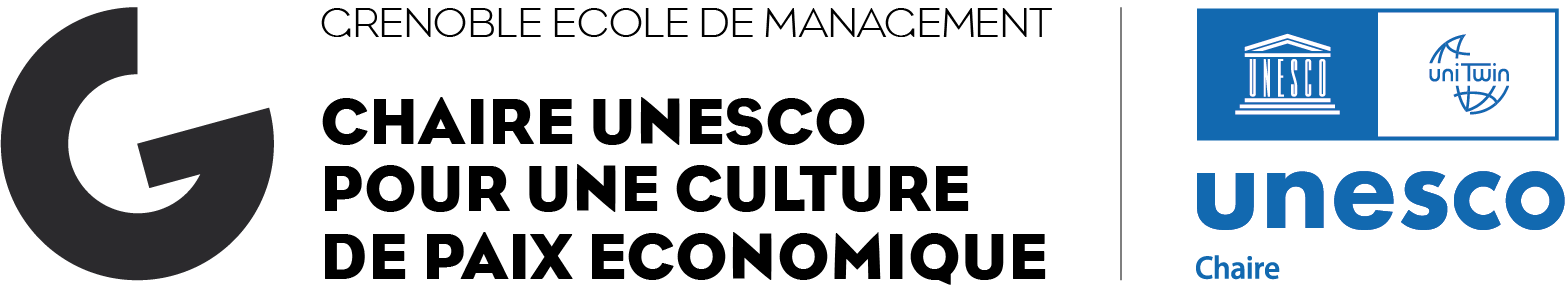Notre rapport culturel à l’échec est source de dégâts sur les individus et les organisations. Or, l’échec, inéluctable, aide aussi à trouver des opportunités.

Isabelle Né, Grenoble École de Management (GEM) et Raffi Duymedjian, Grenoble École de Management (GEM)
L’échec est une situation dont on parle surtout en catimini. On le chuchote, on commente les échecs des autres en espérant ne pas se faire pincer un jour à notre tour. C’est la mauvaise copie montrée devant la classe à l’école primaire, ce mauvais souvenir du bonnet d’âne et du piquet au fond de la classe. Ce sont ces corrections marquées de rouge (sang) et de « peut mieux faire », « n’a pas travaillé », « n’a rien compris », et autres… qui font perdre confiance.
Pourtant cet échec pourrait apporter un apprentissage, une opportunité. Se confronter à la difficulté ne fait-il pas partie de l’apprentissage ? « L’échec n’est qu’une preuve négative ; l’échec est toujours expérimental » (Bachelard, 1932). Ne tombe-t-on pas en apprenant à faire du vélo ? Sait-on gagner une compétition sportive juste après le visionnage d’un champion ? La langue ne fourche-t-elle pas dans la découverte du langage ?
La langue est par exemple un marqueur intéressant mais trompeur de réussite. Nous avons tendance à valoriser un débit de parole rapide, une absence d’à-coup dans le choix des mots. Pourtant, à s’arrêter un instant devant ces experts qui parsèment l’espace télévisuel et qui répondent du tac-au-tac, sans coup férir, aux questions les plus insolubles sur la guerre en Syrie, la politique mondiale ou l’intelligence artificielle, on se dit que l’on aimerait les voir ralentir, réfléchir, voire bégayer. On les sentirait alors en difficulté devant tant de complexité. Ils seraient enfin « à la pointe de (leur) ignorance » (Deleuze, Abécédaire), à cet endroit où la lenteur, le bégaiement, les heurts du langage et de la pensée manifesteraient à la fois son échec et sa véritable production.
Apprécier l’effort
Une étude intéressante de Carol Dweck, professeur de psychologie à Stanford, (2006) montre l’importance de la façon dont on félicite (ou non) les divers apprentissages de l’enfant. Faire l’éloge de l’intelligence de l’enfant va lui faire craindre de ne pas réussir une autre tâche, car c’est son intelligence qui sera remise en cause s’il ne réussit pas. Les traces psychologiques restent, s’accumulent et font trembler devant les défis. Faire, au lieu de cela, l’éloge du travail fourni par l’enfant va lui faire accepter d’essayer des choses, dussent-elles échouer, car c’est l’effort qui est apprécié.
La vision de l’échec est, on le voit bien, culturelle. En France, il est une douloureuse expérience. On évitera d’en discuter lors d’un entretien d’embauche, rien ne paraîtra sur le CV. Il est pourtant des épreuves qui font grandir, prendre du recul, ajuster les valeurs et priorités. Mais parler par exemple d’une démission pour incompatibilité d’humeur est suspect, il faut trouver d’autres explications pour ne pas être catalogué dans la case de l’incapacité à s’adapter. L’échec est vu comme preuve de faiblesse, alors que cette « faiblesse », si elle finit par exister effectivement, comme une peur, une crainte du risque, a été générée et renforcée par notre perception accusatrice (Amadieu, 2006).
Des changements fréquents dans la carrière sont analysés comme une instabilité. En Allemagne, aux États-Unis, en Suisse, les détours d’une carrière plus ou moins couronnée de succès ou d’échecs sont tous marqueurs d’évolution, d’enrichissement, de remise en question, de questionnement. Il y est accepté de changer de métier, de formation, même au bout de quelques mois seulement. Ce ne sont pas là des comportements de girouettes hésitantes, mais d’alouettes qui se saisissent des courants.
L’échec est formateur
L’échec durant les études, de la petite enfance aux études supérieures est jugé comme un enjeu que l’on n’a pas assez préparé, pas intégré, mal compris, interprété différemment. L’enjeu est fort et effrayant. Un examen d’entrée ou de sortie ouvre ou ferme une porte. On voit des candidats se transformer en automates, usant de gestuelles et d’un langage parfois bien maladroit lors de toutes situations de jurys d’embauche ou de concours. C’est bien leur identité qui est touchée s’ils échouent. La non-validation d’un module durant leur parcours d’études peut leur faire passer à côté d’un CDI ou d’une belle opportunité de V.I.E. dans un pays lointain qui aurait boosté leur CV.
Pourtant ils savaient bien qu’ils ne devaient pas échouer. Parfois c’est l’état d’être du moment qui est responsable. Une fatigue accumulée, des grands efforts sur d’autres priorités, une préparation de dernière minute, une grippe, une dispute, une mauvaise nouvelle, un aléa, ou rien que la crainte de l’échec, et c’est le syndrome de la page blanche, la paralysie. Les réponses – ah mais oui ! c’était tellement évident ! – n’arrivent qu’après l’épreuve. Et c’est la fin du monde. La route que l’on s’était fixée est brisée sous une avalanche. Que dire lors de son entretien de recrutement de demain ?
À moins que l’habitude de passer du temps sur ce qu’il y a à savoir, discuter, échanger, transformer, challenger, analyser (les erreurs notamment), ce que l’on a toujours prôné en pédagogie, ne soit plus à l’ordre du jour : apprendre pour la note, en croisant les doigts pour ne pas avoir une défaillance de mémoire, et non pas pour savoir et intégrer.
Là où l’on reconnaît que l’échec est formateur, comme pour le stratégiste qui s’affine au fur et à mesure de ses parties d’échec, c’est bien parce qu’il pousse à l’analyse. Que puis-je faire pour me sortir de là ? Dépasser la blessure émotionnelle de l’égo. « Si l’on n’apprend pas à échouer, alors on échoue à apprendre » (Tal Ben-Shahar, 2010). Où se situent les responsabilités lorsque nous évaluons une situation d’échec ? Le psychologue américain Julian Rotter suggérait en 1954 qu’il y a diverses postures pour interpréter l’échec ; à commencer par différencier le locus de contrôle interne du locus de contrôle externe. Il peut y avoir du positif dans les deux, mais accorder trop d’importance à l’un sur l’autre peut figer dans la crainte et mener à l’échec.
-
Locus de contrôle externe : Vision négative, tout est de la faute des autres, ils m’en veulent, ne m’aiment pas, me mettent les bâtons dans les roues, me condamnent (au secours) ; vision positive, je ne suis pas responsable de tout ce qui m’arrive, il y a des occurrences, je fais ce que je peux (les circonstances seront meilleures demain).
-
Locus de contrôle interne : Vision négative, tout ce qui m’arrive est de ma faute. Je ne suis pas compétent·e, c’est même pire je suis nul·le (je n’y arriverai jamais) ; vision positive, j’ai une part de responsabilité, dans mon comportement, dans mes perceptions, dans le travail que j’ai fourni ; je dois réfléchir à cela (c’est peut-être une opportunité).
L’échec pousse à chercher des solutions
Le psychanalyste Christophe Dejours analyse en 2011 que, dans le travail, on est fréquemment confronté à l’échec, et que c’est cet échec qui nous pousse à chercher des solutions ; tout comme l’artiste musicien aura répété ses gammes un grand nombre de fois, même dans d’immenses frustrations, la danseuse du bal des cygnes aura chuté dans ses innombrables répétitions, le peintre aura fait des erreurs de perspective et des assemblages peu flatteurs. L’instituteur raffinera sa perception de l’ambiance dans la classe. Alors le manager aura lui aussi, à force d’expérience et de connaissances, appris à se sortir de certitudes stéréotypées et de recettes toutes faites pour accueillir les difficultés et les échecs avec optimisme (Michalon & ; Roche, 1996 ; Mintzberg, 2005).
Accueillir l’échec constitue finalement un retour bienveillant vers l’action indéterminée, celle dont on ne sait précisément ce qu’elle sera, qui ne peut suivre des recettes toujours déjà là ; celle qui ouvre toujours au mélange entre beau geste, ingéniosité et efficacité, entre esthétique et performance. Cette réconciliation constitue précisément l’un des axes de réflexion de la Paix économique, remettant en cause les séparations artificielles qui ont trop longtemps imprégné le monde du travail en générant micro-traumatismes et macro-violences préjudiciables à une création de valeur économique et sociale durable.![]()
Isabelle Né, Enseignante-chercheure en Sciences de Gestion, Grenoble École de Management (GEM) et Raffi Duymedjian, Professeur associé,, Grenoble École de Management (GEM)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.