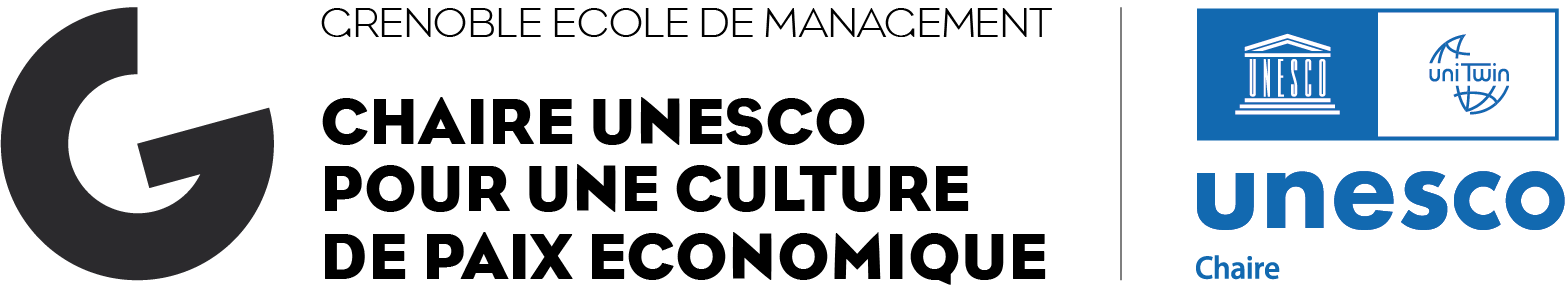La promotion du bonheur n’a jamais été aussi intense. Tou(te)s semblent s’être converti·e·s à ce nouvel eldorado social. Alors « don’t worry, be happy »… mais à quel prix ?
Fiona Ottaviani, Grenoble École de Management (GEM) et Hélène Picard, Grenoble École de Management (GEM)
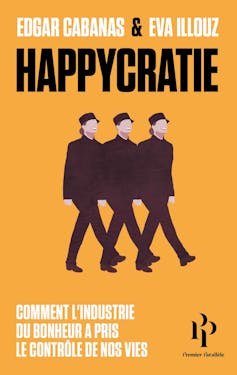
Le récent ouvrage « Happycratie : comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies », de la sociologue Éva Illouz et du docteur en psychologie Edgar Cabanas a relancé le débat sur le bonheur comme finalité sociale de l’entreprise et de la société. Patron·ne·s, politiques, citoyen·ne·s, salarié·e·s, stastiticien·ne·s, grands industriel·le·s, chercheur·e·s, tou(te)s semblent s’être converti·e·s à ce nouvel eldorado social. Alors « Don’t worry, be happy »… really) ? Et à quel prix ?
« Le prix du bonheur », c’est justement le titre français d’un autre best-seller, signé cette fois-ci de l’économiste anglais Sir Richard Layard publié en 2007.
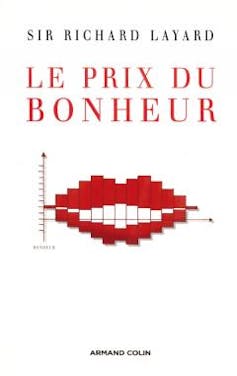
L’objectif de ses travaux est d’aboutir à « une science du bonheur », avec ses lois et ses experts, guidant les comportements individuels et collectifs. Cette conception est welfariste, car elle adopte un critère unique d’évaluation, qui amène à considérer comme secondaire les valeurs que sont la justice, la liberté, l’autonomie, etc. Elle est également positiviste, puisqu’elle considère les indicateurs comme neutres, ce qui n’a rien d’évident si l’on se réfère à la sociologie de la quantification (voir vidéo ci-dessous). Elle est enfin téléologique au sens où elle évalue les actions individuelles, organisationnelles et les politiques publiques au regard de leurs effets sur le bonheur.
Cette triade – welfariste, positiviste et téléologique – constitue à notre sens la marque des approches scientifiques les plus normatives – et les plus problématiques – sur la question du bonheur. Quelle triade alternative est possible ? Pluralisme, constructivisme et pragmatisme constituent une autre approche des questions du bien-être. Mais le champ de recherche très dynamique qu’est aujourd’hui l’économie du bonheur, à la croisée de la psychologie positive et de l’économie, semble être le plus influent du fait de la reprise massive de ses résultats dans les émissions de télévision, les journaux grands publics, les manuels de développement personnel, etc.
Quelles promesses ?
Trouver la manière d’enseigner aux gens de prendre plaisir à vivre, telle est l’ambition du courant de l’économie du bonheur qui poursuit une finalité a priori difficilement contestable : fournir des clefs, des protocoles scientifiquement validés, permettant d’augmenter le niveau de bonheur des citoyen·ne·s et/ou des employé·e·s.
En effet, les personnes évoluent au quotidien dans des contextes sociaux, politiques, environnementaux et organisationnels par ailleurs reconnus comme anxiogènes, déstabilisants, précarisants et inégalitaires. Les impacts de tels environnements sur la santé physique et psychique sont maintenant bien documentés (coûts pour la sécurité sociale du stress, consommation d’anxiolytiques, etc.) À cet égard, donner à chacun·e les clefs pour agir sur son mal-être, spécifiquement en se concentrant sur l’accroissement de son mieux-être, peut sembler une solution économiquement sensée, et humainement louable.
Ainsi, en première analyse, l’idée que le « bonheur » devrait être l’objectif prioritaire des gouvernements et des dirigeant·e·s d’entreprise semble un projet fondamentalement humaniste et éthique.
Tout va très bien alors ?
Dans un contexte de crise sociale, environnementale, démocratique et politique, cet engouement pour le bonheur interroge. Cette réflexion sur l’accomplissement individuel constitue-t-elle un levier d’émancipation et de transformation ? Est-elle un requiem au bonheur avant l’effondrement ? Sommes-nous passés à une forme de ritournelle collective du type « Tout va très bien madame la marquise » ? La poursuite acharnée du bonheur, dans un contexte de malheur généralisé, ne sont-ils pas les signes d’une société à la dérive ?
Sans trancher ces questions, on peut toutefois noter deux grandes dérives liées à la promotion du bonheur. Ces deux dérives sont aussi des symptômes du capitalisme néolibéral. Quand bonheur et néolibéralisme se croisent, qu’obtient-on ? Plus de contrôle et moins de démocratie.
Un bonheur « normalisant »
La normalisation des émotions (positives/négatives) contribue au désarmement des critiques les plus radicales (« happy critique ») et de la mobilisation collective dans les politiques publiques et les organisations. À terme, il est aisé d’imaginer une gouvernementalité des émotions. On voit d’ailleurs déjà se développer en Chine des systèmes de surveillance des émotions dans différentes industries et de notation des citoyens dans les politiques publiques.
Dans les organisations, c’est une « mise au travail » des émotions positives de chacun (puisque cela va aussi avoir un impact sur les ventes) qui se profile. Le bonheur devient alors une nouvelle frontière des modes de management contemporain, qui s’avère destructeurs, notamment parce qu’elles sont source d’épuisement lié aux injonctions à « être soi », et de déshumanisation sous la forme de précarisation, de mise en concurrence ou d’évaluation permanente. Qu’à cela ne tienne, chacun devient responsable de son propre bonheur.
Agir sur ces émotions négatives peut devenir un impératif moral, voir institutionnel : il dépendrait de la volonté de chacun·e de lutter pour son propre bonheur. Avec comme conséquence alors : celle d’un individualisme libéral amenant l’éviction du sujet et celle de la psychologisation de la souffrance, mais aussi (paradoxalement) celle de la pathologisation d’émotions « négatives ».
Que recouvrent de telles tendances ? Derrière ces dérives, on voit poindre une technocratisation du bonheur, renvoyant à la croyance dans les systèmes experts et la montée en charge d’un contrôle, caractéristique de la gouvernementalité néolibérale. On observe alors une croyance en la capacité d’une maîtrise illimitée et individuelle des composantes de l’existence humaine.
Les experts du bonheur tendent à faire croire à la possibilité d’objectiver les composantes de la vie psychique par exemple Mais ce qui n’est pas saisi ici, c’est le caractère performatif des théories scientifiques et des indicateurs associés qui tendent à faire que la vie psychique se conforme à leurs souhaits. Les méthodes usitées – questionnaire d’enquête, neuroéconomie – ne sont pas neutres et demeurent des construits sociaux. L’oubli de leur dimension performative fait par ailleurs courir le risque d’une conformation générale à des comportements, qui seraient ensuite repris comme des données naturelles.
Le paradoxe du bonheur
Dès lors, le risque est que cette conception scientifisante du bonheur conduise à réifier le bonheur comme un objet bien déterminé – amenant à traquer l’indicible – et à concevoir un « prêt-à-être heureux » hors de toute dynamique démocratique et collective pour penser le bien commun.
En somme le bonheur nous met face à un paradoxe : sous un vernis humaniste, ses traductions les plus sombres risquent bien de conduire à l’impossibilité de reconnaître, de contester, et donc d’imaginer des solutions alternatives à des pratiques déshumanisantes. Il est où le bonheur ? Sans doute pas dans la science du bonheur… puisque ultime paradoxe, cet accent mis sur le bonheur nous rendrait malheureux…
Par conséquent cet humanisme de marché, les salarié·e·s et les citoyen·ne·s risquent de le payer cher… Le bonheur n’a pas de prix… Espérons-le en tous cas, car le prix du bonheur semble exorbitant.![]()
Fiona Ottaviani, Enseignante-chercheuse en économie - Grenoble Ecole de Management - Univ Grenoble Alpes ComUE - Chaire Paix économique, Mindfulness, Bien-être au travail - Chercheuse associée au CREG - Université Grenoble Alpes, Grenoble École de Management (GEM) et Hélène Picard, Chercheure, Sciences de gestion, Chaire Mindfulness Bien-être au Travail et Paix Economique, Grenoble École de Management (GEM)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.