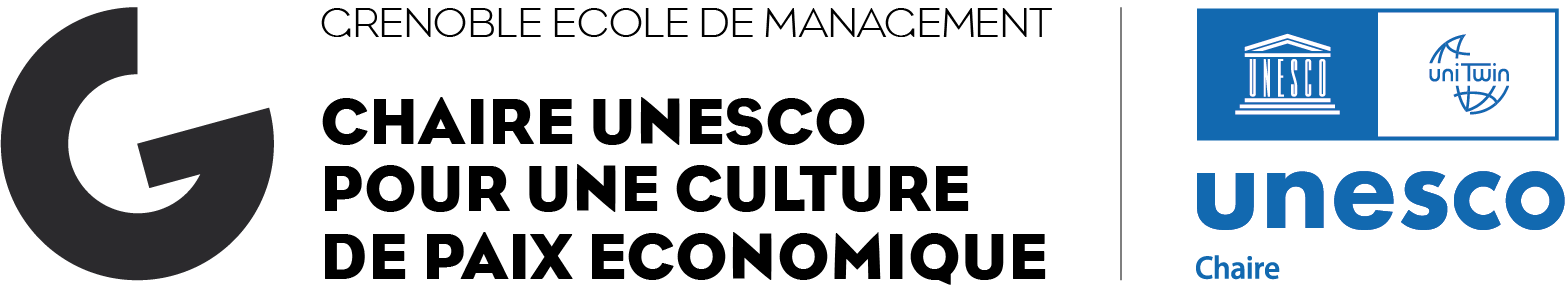Rachel Mutin- Sénéclauze et Dominique Steiler, Directeur Adjoint à la pédagogie de Grenoble École de Management
7 juillet 2010
I/ Constat et difficultés
D’aucuns prétendent que la culture occidentale fondée sur le modèle rationaliste, matérialiste et scientifique s’est enfin émancipée des idéologies religieuses obscurantistes qui aliénaient les esprits et est enfin libre de toute croyance. Aujourd’hui, l’homme moderne ne serait plus en proie aux illusions et aux modèles imposés. Quelle délivrance : vivant désormais dans un monde où l’objectivité garantit nos connaissances, l’homme semble délivré du poids des superstitions, des traditions et divers mythes qui inféodaient l’esprit de ses ancêtres ; il peut penser et agir librement sans craindre la mauvaise fortune ou la vengeance des dieux…
Pourquoi alors cet homme libre n’est-il pas heureux ? Pourquoi est-il tellement en proie au stress, au malaise, notamment au travail, comme s’il n’était finalement en paix ni avec lui- même ni avec ce et ceux qui l’entourent?
Peut- être est- ce parce que la grande mystification moderne consiste précisément dans la croyance qu’on a instillé dans des esprits rationalistes qu’ils étaient au-delà de toute illusion et que la réalité était celle qu’il croyait voir. Or, la réalité n’est jamais que celle de nos schémas mentaux, un ensemble de représentations et de paradigmes d’autant plus invisibles, naturels et évidents qu’ils nous sont transmis ou se répètent et s’automatisent à notre insu.
Peut-être est-ce le moment pour cet individu en proie au mal-être, de remonter en amont de cette situation en s’interrogeant sur les fondements cachés de ses représentations de l’homme et sur la manière dont il envisage sa place dans le monde. Probablement apercevra-t-il alors que son modèle de pensée n’est pas aussi neutre et si dénué d’idéologie et de croyances qu’il le pensait, et qu’il a une incidence sur sa manière de se comprendre et de se vivre.
Interrogeons- le un instant sur les fondements de son modèle de pensée, de son inscription dans le monde, et par suite, sur ce qui sous-tend ses représentations économiques et sociales ?
Il remontera tout d’abord rapidement au modèle cartésien et notamment à l’un de ses aspects qui est celui de la maîtrise. Ce modèle qui définit le substrat-même de cette pensée initiant notre conception moderne est fondé sur le fameux « cogito » : en faisant du sujet rationnel l’origine de toute représentation, Descartes pose le sujet pensant face au monde de la matière considérée comme inerte, objectivable et mesurable. L’homme ne se vit plus comme étant entier, charnel inscrit dans le monde, mais se perçoit comme une entité pensante autonome et bien supérieure à la matière. Il est devant un monde qu’il peut connaître, objectiver par sa science mais aussi posséder. Ainsi l’homme se pense-t-il dans un rapport légitime de maîtrise mais aussi de contrôle, de propriété et de pouvoir sur le monde. De là, un autre postulat culturellement dominant a pris forme : notre existence entière, notre bonheur et le sens de notre vie reposerait sur nos propriétés, sur notre « avoir ». A partir de ce premier pas cartésien, c’est notre univers occidental qui, par cercles concentriques, s’est transformé. D’un avoir matériel, financier, terrien tout est devenu possession ; ainsi l’élève ne cherche-t-il plus à apprendre voir à aimer apprendre, mais à avoir une bonne note. Il n’y a ainsi plus de place pour l’être, plus de place pour le partage ; l’homme ne se définit plus que dans ses propriétés, donc dans ses combats… pour conserver ses biens ou les prendre d’assaut.
« Devenir comme maîtres et possesseurs de la nature », telle est la devise cartésienne qui, présidant au progrès des Lumières, sous-tend notre culture avec l’idée que l’homme s’accomplit dans la rationalité de ses opérations et dans la maîtrise de son environnement. Nous sommes bien loin alors d’autres cultures pour lesquelles la richesse se calcule au peu de biens possédés comme c’est le cas chez les indiens Lakota[1] qui considèrent que si je n’ai rien, c’est que j’ai tout partagé…
Conséquence parallèle, ce paradigme cartésien se prolonge dans une autre direction : celle d’une rationalité calculante, mesurante, qui enferme aujourd’hui les entreprises dans une obsession de l’optimisation, de la maîtrise des coûts, dans le seul but de l’avoir… financier. Ainsi dissimule-t-on grossièrement derrière des objectifs de qualité, une recherche de quantité accrue de gains. Ainsi, aussi haut soit-il dans la hiérarchie, nul n’échappe à la servitude qu’impose à tous ce dieu immanent, ce maître cruel et vengeur bien qu’invisible qu’est le chiffre et son maître, le gain.
C’est là le 2ème paradigme, le 2ème modèle de représentation à interroger : celui qui impose cette notion totalitaire de « gestion » et son prolongement qu’est la guerre dite économique mais aussi intérieure puisque nous sommes embarqués dans une compétition permanente contre les autres et contre nous-mêmes. Cette compétition se trouverait légitimée par notre prétendue « nature combattante » bien que certains anthropologue ne conçoivent plus désormais le développement de l’homme et sa station debout comme une obligation pour détecter les prédateurs et les vaincre, mais bien plus comme résultant de la nécessité de porter les cueillettes pour un partage dans un autre lieu. Ainsi, ce qui associe la gestion à un rapport à l’autre conçu sur le modèle du rapport de force ou de guerre est biaisé. C’est cependant un construit qui n’est pas sans fondement puisqu’il relève de l’origine même du concept de gestion. En effet, celle- ci véhicule deux présupposés :
Tout d’abord, la gestion telle qu’elle est usuellement définie chiffre, évalue, quantifie, dissèque afin de maîtriser les coûts, les flux, les investissements. Telle est sa fonction initiale qui ne pose pas de problème tant qu’elle s’applique aux objets. La difficulté naît lorsque ce concept de gestion outrepasse son champ légitime d’application et est appliqué aux hommes pour en faire ses dévots; il propage alors un modèle issu de la comptabilité mettant l’accent sur l’individuation de composants, de matériaux. Est-il anodin que nous parlions désormais de « ressources humaines » comme s’il s’agissait de composants énergétiques et renouvelables plutôt que de richesses humaines… ou simplement de bureau du personnel ?
Ainsi, un fort individualisme tout d’abord et un matérialisme rampant ensuite, issus tous deux de la doctrine cartésienne, dominent dans des modèles d’organisation où l’on s’efforce de gérer des individus, c’est-à-dire au sens propre, des unités atomisées que l’on s’efforcera ensuite de regrouper artificiellement pour une plus grande efficacité.
Cette double inflexion de nos représentations de l’homme vient alors croiser une autre représentation que nous avons déjà évoquée et dont l’évolution se confirme : l’optimisation des résultats et des performances passe par la maîtrise des coûts, des effectifs, des productions, de la qualité. Le « contrôle de gestion » surveille, inspecte, vérifie, bref contrôle, et boucle la boucle en parachevant le projet initial de la gestion.
A terme, cet enfermement dans un rapport à soi et à l’autre empreint de matérialisme, d’individualisme et de suspicion permanente quant aux performances réalisées, induit une tension à l’intérieur des entreprises, des équipes et de l’individu sans cesse menacé de n’être pas à même de faire le nécessaire pour être productif et compétitif. D’où cette pression dont on parle tant, cette violence physique et symbolique qui s’exerce insidieusement en permanence, générant un stress que les bons managers doivent aussi savoir « gérer. »
Le système prend ainsi le risque ici de se refermer sur sa propre perversion si l’on manque de vigilance. En effet, si l’on observe la manière dont s’instaure le stress au travail, on constate qu’il nait et entretient par la suite un effet pervers, un revers de la médaille pour le manager censé gérer le stress environnant en plus du sien. Ce biais s’installe par ce type d’injonction : « vous devez apprendre à gérer votre stress, vos collaborateurs se suicident. » Ainsi, ceux qui auraient besoin de soutien se retrouvent-ils piégés dans une responsabilisation et une culpabilisation insidieuses : « tu dois suivre cette formation parce que tu es responsable du stress de tes subordonnés, de leur malaise au travail ». Ainsi fragilisé par ses propres tensions, déstabilisé par la disparition de l’un ou plusieurs de ses pairs, cet homme voit sa demande de secours se retourner contre lui et le stigmatiser comme s’il était la source du mal.
II / Les solutions
A / Sortir du modèle de la gestion et de la fragmentation
Il est temps de prendre de la distance par rapport à ces représentations dominantes et loin d’être neutres dans la vision de l’homme qu’elle propose. Cette dévotion moderne au modèle gestionnaire nous fait oublier que l’homme n’est pas un composant que l’on gère en lui apprenant à scinder sa vie en différents espaces étanches : d’un côté la vie professionnelle, l’apparence publique, les impératifs objectifs et les performances ; de l’autre la vie privée, le ressenti personnel et l’incidence subjective avec lesquels l’individu doit se débrouiller tout seul. Ainsi la gestion instaure une forme de dualisme schizophrénique puisqu’elle incite à tout séparer, rationaliser, distribuer pour supporter une réalité économique de plus en plus difficile et contraignante tout en feignant d’ignorer que cela peut potentiellement affecter celui qui l’applique. Tel est le mythe qu’elle véhicule ensuite pour motiver ses troupes : sera considéré comme un bon manager celui qui saura refouler ses frustrations et émotions ; sera un faible celui y succombera. En effet, on dira que l’individu sait « gérer » une situation quand il donne l’impression d’être étanche, imperméable à ce qu’il vit. Il sera considéré comme performant s’il sait masquer ses émotions, « prendre sur lui »… Expression intrigante : sur quelle part de lui- même prendra-t-il ? Sur sa part privée ? Comment s’étonner de cette augmentation du stress et du malaise au travail quand on demande à une personne de se scinder intérieurement pour mettre de côté ses émotions et son ressenti, pour ne plus entendre les signaux d’alarme intérieurs qui l’alertent d’un trop plein imminent ? Comment ne pas interpréter ces multiples maladies somatiques sans entendre la révolte des corps qui flanchent, épuisés, méprisés… Ce corps que notre civilisation, dans son dualisme, ne considère que comme un outil, un instrument au service de notre puissance, se révolte et trahit l’esprit, mettant en échec sa détermination à tout contrôler, à tout maîtriser là où, dans d’autres philosophies, d’autres civilisations, il en est la modalité d’existence et l’expression privilégiée ; cette partie de nous qui ne ment jamais… contrairement à notre mental.
Là est l’illusion car l’homme est une unité qui ne peut se fragmenter et qui interagit en permanence avec ce qui l’entoure, éprouvant, ressentant les choses. Il n’y a pas contrairement à ce que l’on voudrait nous faire croire, d’un côté ce qu’il vit intérieurement, de l’autre ce qu’il vit extérieurement, d’un côté ce qu’il vit professionnellement et de l’autre ce qu’il vit moralement.
Il faudrait cesser de tout se représenter sous le mode actuel de la gestion : l’homme n’est pas un objet gérable parce qu’il est d’abord une unité et qu’il ne peut être par ailleurs être réduit à ce que la rationalité nous permet d’en comprendre.
A force de vouloir étendre à tout ce concept totalitaire de gestion, on finit par insinuer dans l’esprit des individus, l’idée qu’ils sont en compétition permanente contre les autres et contre eux- mêmes, induisant là une violence symbolique et psychique, permanente et destructrice.
Ne pourrait-on pas imaginer un management fondé non plus sur un modèle gestionnaire où le sujet gère en mettant à distance, en organisant rationnellement les choses mais sur un modèle coopératif où l’individu serait considéré dans sa richesse, sa complexité et son unité profonde en parfaite interaction avec un extérieur qui l’implique affectivement, psychologiquement et moralement ? Cet humain là requiert, pour trouver son équilibre entre des forces antagonistes, intérieures et extérieures, du temps, de la compréhension, un rythme particulier à chacun et l’acceptation parfois, souvent, de son impuissance à tout maîtriser… de sa volonté de s’inscrire dans la nature des choses, plus que de vouloir en être le maître… autant de notions étrangères à la gestion.
Ainsi le modèle de la gestion nous enferme-t-il dans une vision atomisée des individus et des tâches. Or, il est une sagesse antique dont le rationalisme devrait rassurer les esprits modernes inquiétés par des termes qu’il pourrait facilement associer à l’occultisme, appelé stoïcisme, qui développe une sagesse susceptible d’apporter une solution au malaise de l’homme moderne : son idée fondamentale est que nous appartenons à un grand tout, à un cosmos organisé rationnellement (les grecs diraient un logos), et que notre agir relève d’une même logique universelle. Le bouddhisme dirait, dans le même esprit, que nous participons à une même énergie. Or, les récentes découvertes en physique quantique tendent à confirmer cette idée selon laquelle tous les êtres seraient corrélés dans l’univers ;l’action de chaque être aurait une incidence sur le reste du monde. Ainsi serait remise en question l’efficacité de notre modèle actuel fondé sur l’individualisme et l’atomisation des êtres. La science viendrait donner raison à des expériences réalisées en 1974 par le philosophe et psychologue Anatole Rapaport de l’université de Toronto qui a montré qu’à long terme, un système coopératif et fondé sur l’entraide et la fraternité est plus efficace que le chacun pour soi. Ainsi, la manière la plus « efficace » de se comporter vis à vis d’autrui serait, à terme, la coopération, la réciprocité et le pardon, des notions indéniablement étrangères à la logique d’entreprise mais qu’il faut espérer voir apparaître bientôt dans les discussions au côté de l’éthique à condition qu’elles ne soient pas utilisées que comme des outils de communication pour renforcer le modèle actuel sous couvert de bons sentiments.
B/ Sortir plus généralement du modèle de la maîtrise dont est issue la gestion pour redécouvrir l’intériorité, soubassement de toute paix économique
Il faut par ailleurs abandonner l’illusion du scientisme et des Lumières encore latente dans nos esprits qui confine au mensonge : l’homme ne parvient pas à tout maîtriser et il n’y parviendra jamais. Une partie de ce qui l’entoure échappe à son contrôle. Or, l’homme moderne supporte mal cette idée qui ne peut tout contrôler ; pourtant, cette illusion est destructrice car niant la réalité, elle pousse l’homme dans une impasse.
Dans d’autres temps et d’autres sociétés, cette impuissance partielle de l’homme à tout maîtriser était vécue comme naturelle car l’homme lui-même se sentait partie intégrante de cette nature. Elle est désormais perçue dans notre société comme un défaut, un manque à gagner.
Il faut ainsi non seulement maîtriser, « gérer » ses comptes mais aussi sa carrière, son temps, ses relations, sa vie privée. Nous sommes des guerriers de l’action. Seul le visible, l’éclatant semble faire sens et fonder notre existence aux yeux du monde.
Pourtant si l’on garde en mémoire ce qu’était un guerrier à l’époque des chevaliers, des samouraïs ou encore des chefs de tribus arabes pré-islamiques, nous constatons qu’il était d’abord celui qui cherchait à éviter la guerre et puisait sa paix et sa volonté de partage dans une discipline intérieure. Ainsi en était-il des chevaliers poètes, des samouraïs bouddhistes et des chefs arabes vainqueurs de joutes poétiques. L’accomplissement intérieur semblait alors inséparable de la puissance, mais plus encore en était la condition sine qua non. Combattre sans pensées, sans vouloir maîtriser les choses par la réflexion, en laissant la nature des choses guider mes gestes… telle était l’exigence suprême à laquelle il s’astreignaient, faisant de leur paix intérieure l’ultime critère pour atteindre la perfection du geste, de l’action.
La puissance se mesurait alors à la force de l’intériorité du sujet qui orientait par suite son agir dans le sens d’une coopération et d’un partage tandis que l’homme moderne est certain que son accomplissement se fera en s’érigeant contre le monde et en lui imposant sa domination. Ainsi pouvons- nous constater avec R.Blondin[2] qu’aujourd’hui, « si les hommes guerriers sont généralement partant pour les changements humanitaires majeurs, les changements personnels leur posent davantage de problème. »
A l’opposé de cette paix qui guide l’agir des anciens guerriers, l’homme occidental moderne évalue par suite son emprise sur les choses par la souffrance qu’elle engendre. Ainsi mesurons- nous toujours la valeur d’un travail à l’effort qu’il a demandé : « gagner son pain à la sueur de son front. » Cette conception guidée par notre histoire (étymologie de travail = tripalium ; instrument de torture) fait comprendre le paradoxe du stress aujourd’hui. Tandis que notre ère valorise le bien- être, le stress est fuit car il est vécu dans la souffrance, mais dans le même temps, il est recherché comme preuve de mon importance ; le bonheur ferait trop courir le risque d’être vu comme un parasite cherchant à s’économiser.
Au final, l’homme se trouve aujourd’hui dans la situation de l’insensé décrit par Epictète[3] : il se bat contre ce qui ne dépend pas de lui et qu’il cherche en vain à changer, ce qui le rend malheureux, alors que la sagesse serait de changer ses représentations qui, elles seules dépendent de lui et sont susceptibles de lui apporter la paix intérieure. Mais ces schémas qu’il véhicule à son insu sont d’autant plus opérants qu’il se croit désormais libre de tout présupposé tant ce modèle matérialiste et gestionnaire a su recouvrir et s’imposer dans tous les espaces de la vie.
S’il parvenait à se délivrer de son besoin de maîtrise avant qu’il ne se retourne contre lui pour se faire moyen de pression, l’homme retrouverait alors une paix intérieure fondée non pas sur l’absence de conflits extérieurs, de tensions, mais sur un équilibre vie intérieure / événements extérieurs toujours à reconstruire, vécu non plus sur le mode d’une menace permanente (qui suscite un positionnement défensif qui pour une part est celui de la maîtrise) mais dans une attitude d’accueil et de paix intérieure face à tout ce que je ne pourrai jamais maîtriser. Ainsi aurait- il à apprendre des Stoïciens pour qui la paix intérieure consistait dans la mise en adéquation, par un travail rationnel, de mes représentations et de la réalité. C’est cet accord du vécu et du réel qui peut seul rendre heureux et apporter au sage la paix intérieure, c’est-à-dire l’absence de troubles.
Autrement dit, le bonheur n’est pas dans une absence de problèmes extérieurs mais dans mon attitude d’accueil ou non de ces réalités. Ainsi, dans le modèle culturel chinois, les circonstances sont accueillies et vécues comme des occasions d’avancer et d’orienter nouvellement un projet sans que l’on cherche à forcer leur orientation pour qu’elles se plient à des contraintes extérieures comme le ferait un manager occidental réticent à croire que la non- action et l’accueil de ce qui est puisse parfois être le gage de l’efficacité.
C/ Sortir du « faire » pour retrouver l’ « être »
Une des questions que nous nous posons dès que l’on nous invite à changer de posture, de projet, d’orientation est souvent « à quoi ça sert ?» ou « pour quoi faire ? », deux expressions symptomatiques de la valeur que l’on ne consent à accorder aux choses que si elle sont utiles. Mais de quelle utilité parle-t-on alors ? Celle qui rapporte immédiatement un profit en monnaie sonnante
et trébuchante ou celle qui enrichit l’homme de manière quasiment invisible en nourrissant ses besoins et désirs profonds ? Que dire à nos étudiants qui, au bout d’un certain temps passé à l’école, se demandent à quoi tout cela rime, à quoi ça sert ? Comment ne pas voir que pour eux, le fait de se poser la question est déjà biaisé parce qu’ils y voient le signe d’une mauvaise orientation, d’une erreur d’aiguillage et parce qu’ils pensent alors en terme d’application pratique, de profil professionnel adéquat ou non à leurs compétence, à ce qu’ils peuvent faire.
Si les étudiants se posaient la question non pas de ce qu’ils veulent faire en terme de débouchés mais de ce qui leur plait à partir de ce qu’ils sont ou veulent être, alors ils trouveraient en eux l’origine de leur motivation et penserait en ces termes « quelle est ma vocation, ce que je suis appelé à apporter dans ce monde ? » Peut- être découvriraient- ils alors une possible adéquation entre leur énergie propre, leur finalité et le monde qui se traduirait alors par ce terme difficilement envisageable pour beaucoup de « bonheur au travail ». La solution qui s’ouvre ici consisterait en un mot à retrouver le chemin de notre intériorité. Mais cela n’est pas une démarche facile car elle implique que l’on remonte à contre- courant de nos représentations modernes objectivantes où l’homme se réduit à son avoir, à sa propriété, à son extériorité, et n’existe qu’à travers sa capacité d’action sur.. Or, si l’on se réfère à l’histoire des idées, on voit que ce schéma ne s’est lui- même imposé qu’en écrasant la subjectivité et l’intériorité considérées comme anti- scientifiques. On comprendra donc très bien que ces notions soient d’emblée disqualifiées et suspectes puisque c’est contre elles que s’est en partie établi le modèle dominant.
Il ne s’agit pourtant pas pour nous de faire un bond en arrière dans un monde aux conceptions pré-modernes, mais bien en avant en réconciliant ces deux modalités d’être que sont l’intériorité et l’extériorité que l’on a cru jusque là devoir choisir séparément en privilégiant toujours l’une au détriment de l’autre. Retrouver une intimité avec notre intériorité, ce ne serait pas nier notre extériorité mais la remettre à sa juste place afin que dans un dialogue retrouvé, intérieur et extérieur trouve un équilibre harmonieux qui nous épargnerait de nous sentir constamment menacé par cet extérieur envahissant car n’ayant guère de contre- poids pour le modérer.
Cela impliquerait aussi que l’on change profondément mos représentations en renonçant entre autres à trouver notre richesse dans un avoir extérieur et qu’on la cherche dans notre être intérieur. Malheureusement, cette notion d’intériorité tout comme celle de pardon, de réciprocité, de partage et de don, s’avère elle aussi très connotée dans le monde du travail et prête à sourire, discréditant immédiatement le sérieux de celui qui oserait la proposer. Celui- ci serait immédiatement taxé de soixante- huitard attardé ou d’utopiste new age suspect de ne pas savoir garder dans la sphère privée ce qui est de l’ordre de ses convictions. Certes l’entreprise se veut rationnelle et sérieuse mais elle doit comprendre que pour être vraiment responsable et durable, elle doit intégrer ces notions dans ses représentations afin que puisse naître un nouvel être-dans- l’entreprise.
[1] Maslow, A. : Etre humain : la nature humaine et sa plénitude, Paris, Eyrolles, 2006.
[2] Blondin, R. Le guerrier désarmé. Montréal, Boreal, 1994.