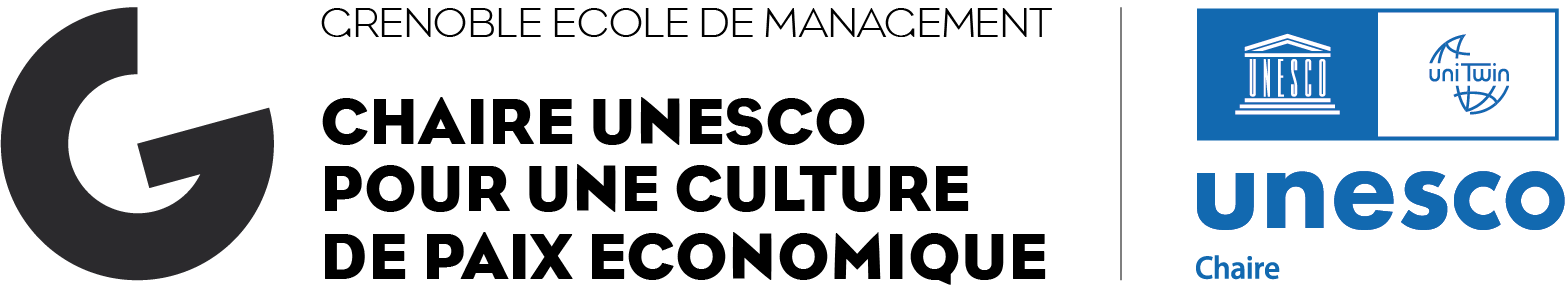Les échanges du colloque « Travailler demain » ont offert un éclairage précieux sur les bonnes pratiques managériales à mettre en place pour accompagner au mieux les évolutions actuelles.

Benoît Meyronin, Grenoble École de Management (GEM)
J’ai eu le plaisir de participer, le 30 novembre dernier, au colloque « Travailler demain », organisé par plusieurs institutions universitaires et l’institut Esprit de Service du Medef, à l’initiative d’Aline Scouarec, professeur à l’IAE de Caen. J’y présentais un papier académique co-écrit avec Jean‑Jacques Nilles, professeur à l’Université de Savoie, mais ce n’est pas le sujet que je souhaite développer ici (il portait sur une forme d’éthique spécifique aux métiers de service).
Mon propos est de partager les quelques réflexions que les interventions que j’ai eu le plaisir d’entendre m’ont inspiré et qui permettent d’envisager le futur du travail en termes de relation entre l’employeur et l’employé : il y est question de care (du prendre soin des équipes), bien sûr, de reconnaissance, toujours, mais aussi de l’évolution du métier RH et de la question des mobilités du quotidien mises en lumière par le récent mouvement dit des « gilets jaunes »… Rapide tour d’horizon, en démarrant par ce dernier sujet.
Prendre soin des équipes : « Dis-moi où tu vis et où tu travailles, je te dirai comment tu vas (mal) »
Les échanges m’ont d’abord fait penser aux travaux de Laurent Davezies, professeur au CNAM, lorsqu’il développe la thèse de l’éclatement de nos lieux de vie, avec cette tripartition de plus en plus banale entre le lieu où l’on habite, celui où l’on travaille et celui où nous consommons (qu’il s’agisse du shopping de Noël ou des stations de ski, pour être dans la tonalité du moment).
Bref, cette dissociation des lieux n’est pas sans conséquence sur nos mobilités du quotidien. Certes, avec le développement du télétravail – de grandes entreprises proposent ainsi jusqu’à deux journées par semaine dans un cadre légal qui désormais le favorise grandement – cette désynchronisation tendra peut-être à se réduire un peu, mais le mouvement des « gilets jaunes » tend à souligner combien la question des déplacements pendulaires domicile – travail est aujourd’hui une question de société.
En ce sens, travailler demain, c’est donc imaginer des solutions innovantes pour résoudre cette équation spatiale créatrice d’inégalités sociales, une autre forme de la « lutte des places » dont parle si justement le géographe Michel Lussault. Et il me semble alors que parler d’expérience collaborateur, de symétrie des attentions ou, comme je le fais, de management par le care, implique de se soucier de cette équation – et certes le télétravail peut y participer, mais pour certains types de métiers seulement.
Dans tous les cas, il incombe aux entreprises, à la convergence de leurs politiques RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et RH (ressources humaines), d’aider à résoudre une équation spatiale complexe créatrice d’expériences collaborateurs négatives (fatigue, stress et inconforts divers liés au temps de trajet) dont les coûts « cachés » (notamment en termes de turnover et d’absentéisme) sont loin d’être négligeables.
Une DRH plus connectée au « business »
Travailler demain, cela signifie aussi que l’on développe une certaine vision du futur du métier RH. Qui, en effet, est plus légitime pour accompagner les changements, préparer l’adaptation des compétences notamment ?
Or, cela implique de mieux connecter le métier RH aux modèles économiques du futur (et je parle à dessein au pluriel, car il est très probable que les entreprises auront de plus en plus non pas un mais DES modèles de revenu). Car si les directeurs·trices des ressources humaines ne participent pas aux réflexions amont sur les évolutions des modèles d’affaires, ils ne pourront pas « prendre leur place », c’est-à-dire anticiper les transformations.
Plus concrètement, et c’est le consultant André-Benoît de Jaeggere qui a précisé ce qui suit lors du colloque, cela veut dire :
- Un·e DRH plus impliqué·e sur le terrain de l’innovation/des nouveaux modèles économiques, notamment via les écosystèmes ouverts (Open Innovation) qui se développent partout, sous des formes variées – fab lab, lab d’innovation, incubateur, etc. Dans ces lieux s’élaborent des innovations, des pratiques nouvelles, des hybridations… dont les RH doivent pouvoir être non seulement parties prenantes mais initiatrices ! En étant présentes dans ces cercles, en y apportant leur regard et leur sensibilité, en veillant à y impliquer l’ensemble des collaborateurs, ils sont dans leur rôle.

- Plus globalement, les ressources humaines devraient être les garantes d’une ouverture plus grande sur l’extérieur, j’ai coutume de dire une « oxygénation », dans les secteurs traditionnels dans lesquels, très souvent, les équipes n’ont connu « que » cet aspect du monde. En aidant à décloisonner, en facilitant cette forme de mobilité (intellectuelle), le métier RH joue un rôle clé. Car l’entreprise ne s’ouvre vraiment sur son environnement extérieur que si chacun·e se sent concerné·e et possiblement moteur dans cette dynamique des frontières étendues.
Les nouvelles formes de reconnaissance, ou la « société des deux piliers »
Comme nous l’enseigne le sociologue Jean Viard, et cette vision était opportunément reprise dans les échanges par le délégué général de la FNEGE (Fondation nationale pour L’enseignement de la gestion des entreprises) et ancien professeur à l’ESSEC Maurice Thévenet, nous sommes aujourd’hui dans une société qui valorise autant le travail que les loisirs, ces deux piliers de nos vies.
En ce sens, il ne s’agit pas de dire que le travail ne compte plus, mais simplement de réaffirmer qu’il compte autant que les autres activités humaines. Le travail n’est pas second, mais bien à parité avec nos loisirs, car il demeure une source incontestable d’identité et d’estime sociale, donc de reconnaissance, au sens où l’entend le philosophe et sociologue allemande Axel Honneth.
Cela ne signifie donc pas que la quête d’un équilibre entre nos vies personnelles et professionnelles se jouerait toujours et systématiquement à la défaveur du premier, que nous tendrions à privilégier : il s’agit bien d’un équilibre dans lequel nos vies professionnelles sont une composante essentielle de ce rapport à soi positif que nous recherchons tous et qui est si dépendant du rapport aux autres – nos collègues, nos managers, etc.

Le second pilier, celui des loisirs, ouvre donc un formidable espace à notre besoin de reconnaissance et les entreprises pourraient donc y rechercher de nouvelles formes de valorisation de leurs collaborateurs – en soutenant, par exemple, l’activité de YouTuber de son collaborateur dès lors qu’elle porte sur un sujet qui a du sens pour elle – la protection de l’environnement par exemple. Avec, évidemment, son assentiment, et dans le respect de sa vie privée. Travailler demain, c’est sans doute reconnaître toujours plus et autrement.
« Qualité du travail au travail »
Avec un coût de l’absentéisme au travail évalué à plus de 100 milliards d’euros chaque année en France (oui, vous avez bien lu !), il devient évident que la question ne peut se limiter à la qualité de vie au travail, mais qu’elle doit englober une réflexion sur l’utilité perçue du travail. Je rejoins ici la vision que porte l’anthropologue britannique David Graeber lorsqu’il développe son analyse des « Bullshit Jobs », c’est-à-dire ces métiers dont l’utilité pour l’opérateur lui-même est loin d’être évidente (alors même qu’il s’agit d’emplois relevant, pour la plupart, du tertiaire supérieur).
En ce sens, la « qualité du travail au travail » évoquée par Maurice Thévenet renverrait tout à la fois à son sens (c’est-à-dire à son utilité sociale et à ses bénéfices en termes d’estime sociale pour revenir à Alex Honneth), à la qualité des relations que j’y noue (avec mes collègues comme avec mon manager et/ou mes clients et partenaires externes), à l’aune de ce besoin de convivialité et de « faire communion » dont le sociologue Michel Maffesoli parle si justement dans son ouvrage « Homo Eroticus : des communions émotionnelles ».
Où l’on voit qu’il ne suffit pas de créer des occasions de « faire la fête » (même si cela compte !) et d’installer des baby-foot pour faire corps ensemble et donner ainsi une vraie dimension socialisante et porteuse de « bien-être » au travail.
Concrétiser l’éthique du care
Pour finir, quel bonheur d’entendre François Silva, professeur à Kedge Business School, parcourir les sujets « qui comptent » pour lui aujourd’hui :
-
« L’élément central, c’est la relation », ce qui est bien une manière de définir cette forme d’éthique… et ce qui nous renvoie au paragraphe qui précède.
-
« Libérer la parole, savoir se parler », quand l’éthique du care souligne l’importance du « pouvoir de dire » (en l’occurrence, que l’on donne ou non aux équipes). Il cite une étude de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) qui met en lumière un sujet formulé d’une façon intéressante : « Apprendre à discuter ».
Autrement dit, utiliser l’art de la conversation en entreprise comme premier levier de considération… Savoir se parler, c’est en effet une marque de cette « reconnaissance mutuelle » chère à Axel Honneth qui ne serait donc plus si commune aujourd’hui dans nos entreprises.
François Silva a enfin souligné que cela n’était pas sans conséquence sur le rôle des managers : être eux-mêmes en situation d’écoute, favoriser une parole libre mais respectueuse de chacun·e, se positionner comme le médiateur de cette parole, et, partant, des idées, propositions, suggestions… de son équipe.
Des managers qui ont donc une grande responsabilité dans l’accompagnement des évolutions trop rapidement évoquées ici et qui sont à l’origine d’une transformation profonde du travail.![]()
Benoît Meyronin, Professeur senior à Grenoble Ecole de Management, Grenoble École de Management (GEM)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.