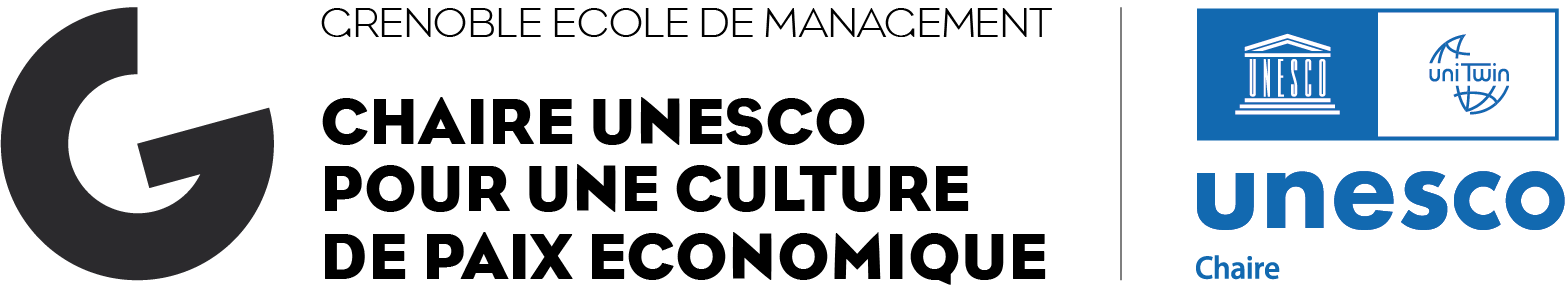Raffi Duymedjian - The Conversation

Raffi Duymedjian, Grenoble École de Management (GEM) et Isabelle Né, Grenoble École de Management (GEM)
Qui n’a jamais été bloqué dans son élan par un individu, les yeux rivés sur l’écran de son smartphone, tentant de trouver l’angle du selfie parfait ? Qui n’a pas été stupéfait de constater à quel point l’extrême concentration sur ces petits rectangles lumineux perturbe la perception du hors champ de l’écran et empêche de constater les ralentissements provoqués par l’usage du smartphone sur les mouvements alentour ?
![]()

Les questions qui parcourent tout ou partie de la société à l’encontre des smartphones se focalisent essentiellement sur leur dimension sociale. Ce petit objet est accusé de rompre les relations sociales de proximité au profit d’interactions virtuelles, d’engendrer une solitude entourée, de perturber les habituelles convenances entre individus quand chaque sonnerie vient interrompre, par un œil jeté sur le SMS fraîchement tombé (comme on disait à une certaine époque d’une dépêche) ou pire, par une prise de ligne (désignation très XXième) la précieuse conversation de face à face que nous désespérions d’avoir avec un ami perdu de vue.
En revanche, il est moins fréquemment question de parler smartphone en termes de vitesse et de mouvements, sauf de façon élogieuse : le smartphone est le parfait complément de ce qu’était l’automobile au XXIe siècle, un objet de libération. La voiture, cheval des temps modernes permettait d’étendre l’espace de déplacement individuel (quand les transports collectifs tel le train nous imposaient la promiscuité d’inconnus).
Le smartphone coupe le fil à la patte de l’ancien téléphone et brise également la contrainte sociale de l’espace « public » associé (rappelons-nous ces files d’attente autour du téléphone familial…). Le smartphone est donc l’outil idéal du nomade qui part le cœur léger et le smartphone rempli d’applications qui seront autant d’outils mobilisables tout au long de son périple.
Pourtant, comme nous l’avons souligné en introduction de ce texte, le smartphone ne participe pas uniquement à une accélération des mouvements, à une fluidification des déplacements dont on sait à quel point ils accompagnent le développement d’une société de marché (qui prône la libre circulation de tout ce qui est en mesure de circuler).
Il provoque également des ralentissements individuels de toute nature : tel véhicule réduit brutalement sa vitesse car son conducteur peine à gérer sa trajectoire et sa discussion téléphonique. Telle discussion entre amis, intense par son débit de parole et la richesse des idées partagées stoppe brutalement à chaque sonnerie (y compris celles provenant de tables environnantes qui provoquent soudainement une palpation collective). Telle démarche rectiligne et énergique doit dangereusement ralentir et pivoter à l’approche d’individus plantés ici et là en diverses postures, du selfie entre potes au point and shoot d’un monument en vue en passant par une discussion téléphonique gesticulée ou un frénétique tapotage bipouce de SMS.

Le smartphone, de faux airs de slow
Certes, nous pourrions alors noter les vertus du smartphone à participer au mouvement slow. Dans notre course effrénée vers une performance accrue, nous avons technicisé chacun de nos gestes à un tel point que chaque seconde gagnée nous paraît convertie en espèces sonnantes. Et le mouvement slow, qu’il relève de la consommation, de la production ou de management, promeut des ralentissements producteurs de valeurs dépassant largement la simple création de valeur monétaire à court terme. Mais les ralentissements propres au smartphone n’appartiennent en rien à la logique du slow car, plutôt que de nous ouvrir à la richesse de l’instant en y puisant les ressources d’une action de long terme, le smartphone nous enferme immanquablement dans le micro espace-temps du l’écran.
D’aucuns pourraient rétorquer que cet espace-temps est précisément beaucoup plus ouvert que l’ici et maintenant dans la mesure où l’écran du smartphone peut renvoyer à d’autres lieux comme à d’autres fuseaux horaires, supprimant ainsi les rugosités propres aux déplacements physiques. Or, ce sont précisément ces rugosités que promeut le slow, ces aspérités plus ou moins prégnantes qui forcent l’attention aux choses et aux gens.
Nos mères nous sermonnaient quand nous décrochions l’antédiluvien téléphone fixe (les auteurs de cet article ayant dépassés la cinquantaine), nous submergeant de règles aussi « évidentes » que : « n’appelle pas aux heures de repas », « n’appelle pas trop tard » ou « soit bref ». Ces principes ont en partie disparu et nous oublions allègrement les différences temporelles ou culturelles, nous adressant à notre interlocuteur comme à un autre nous-mêmes.

Mais ces différences refont surface très régulièrement au point que les ouvrages sur la communication virtuelle enfilent sinon des lieux communs (attention à l’heure qu’il est chez vos interlocuteurs), du moins les vieux savoirs recyclés à la sauce numérique (« attention, dans certains pays, un oui, peut signifier tantôt je comprends, tantôt non, tantôt… oui », connaissances que l’ethnologie a dans certains cas découvertes il y a plusieurs siècles.
Parasitage de la coopération
Plus grave, à l’heure où le collectif est le Graal des pratiques organisationnelles, sous des formes aussi classiques que la gestion de projet au sens le plus traditionnel du terme parfois mâtiné de virtualité (les fameuses équipes virtuelles), ou plus « innovantes » comme les processus d’intelligence collective, l’usage du smartphone marque la perte d’un sens : celui de la perception de l’espace environnant et, surtout, des partenaires potentiels à la coopération.
L’étude des sports collectifs fait apparaître comme centrale la capacité à saisir la position de ses collaborateurs afin de développer le jeu collectif, ce que Pierre Parlebas désigne par la notion de situation socio motrice. Ce sens est d’ailleurs probablement associé à la proprioception, cette facette de la kinesthésie qui permet de connaître la position de notre corps dans l’espace. Or, les embouteillages provoqués par les smartphones révèlent une coupure vis-à-vis du monde proche au profit d’une concentration centrée sur cette petite lucarne lumineuse et une absence manifeste de ce sens.

Richard Nisbett, dans The Geography of Thought (2004), proposait d’expliquer les différences de perceptions infraconscientes entre Américains et Chinois (plus exactement l’espace sinisé – Chine, Japon, Corée, Vietnam) par les modalités de l’action collective. Quand un Américain voit des poissons nageant dans un aquarium, un Chinois percevra un aquarium contenant algues, rochers et… poissons. L’un se focalise sur les objets saillants (pour le coup les animaux en mouvement) quand l’autre perçoit l’aquarium dans son ensemble en saisissant ainsi plus finement les rapports entre les différents éléments qui le composent.
Or, Nisbett ramène cette différence à celle qui distingue une culture individualiste, celles issues de la Grèce antique qui construit l’individu comme un être de volonté, solitaire, seul responsable de ses actes, et d’autre part une culture plus collectiviste fondée sur le modèle de pratiques agricoles, pour laquelle tout le village aide à la cueillette de chaque parcelle et qui promeut l’harmonie. Dans ce cas, une attention toute particulière est exigée à l’encontre de ses voisins dont la présence continûment perçue, ici et maintenant, est condition de réussite de l’action collective.
Le smartphone ne participerait-il pas de ces pratiques individualisantes qui rendent virtuels l’espace et les individus présents, en donnant, pour partie faussement, plus de concret à l’ailleurs ?
Raffi Duymedjian, Professeur associé,, Grenoble École de Management (GEM) et Isabelle Né, Enseignante-chercheure en Sciences de Gestion, Grenoble École de Management (GEM)
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.