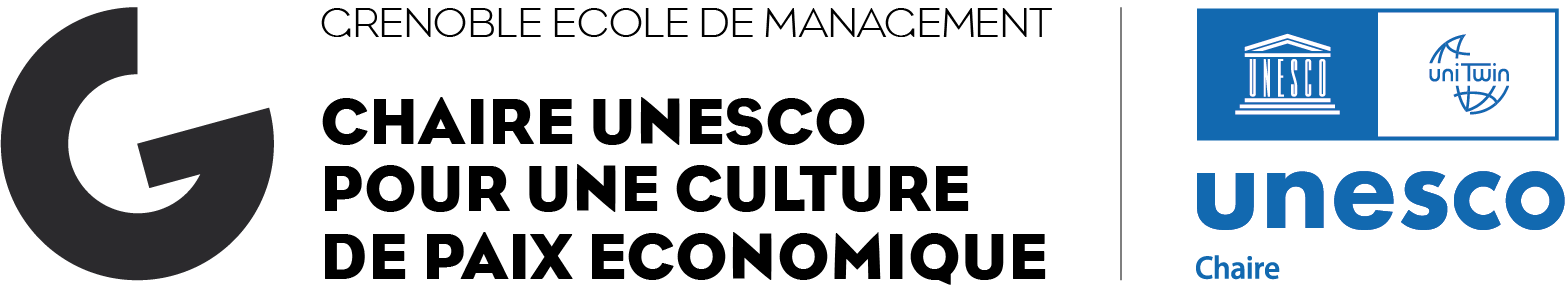Hugues Poissonnier - The Conversation
 « Growth » sans fin ? Thibauld Nion/Flickr, CC BY-SA
« Growth » sans fin ? Thibauld Nion/Flickr, CC BY-SA
Hugues Poissonnier, Grenoble École de Management (GEM)
À l’heure où la campagne électorale s’oriente enfin vers les idées et les propositions, la croissance occupe, comme c’est le cas depuis de longues années et plusieurs élections déjà, une place centrale. Pour les candidats, il ne s’agit pas de faire part d’ambitions débordantes. Le chiffre de 2 % par an serait considéré comme un succès par n’importe quel candidat (rappelons qu’entre 2000 et 2016, la croissance annuelle a été de 1,3 % par an en moyenne en France, chiffre identique en Allemagne). ![]()
Pourtant, faire de la croissance du PIB la mesure ultime de la performance économique d’une politique me semble à la fois anachronique, illusoire et dangereux.
La croissance : un objectif consensuel qui transcende les divergences de vues
Bien que les partis politiques soient régulièrement fustigés et remis en cause, les anciens clivages demeurent concernant les modalités de renforcement de la croissance. La relance de la demande des ménages et publique est toujours au cœur des politiques de gauche, qui conservent à la vision keynésienne la même confiance historique.
La réduction des déficits obtenue par une politique davantage vue comme vertueuse qu’empreinte de rigueur (personne, hormis les journalistes, n’utilise encore le terme) constitue la principale recette envisagée à droite en vue de renforcer la compétitivité et l’investissement des entreprises.
La volonté de « libérer la croissance » affichée par Emmanuel Macron s’inspire quant à elle assez largement du rapport Attali (2010) et valide l’idée selon laquelle la croissance mérite d’être érigée en objectif majeur, si ce n’est ultime. Dans tous les cas, la vision privilégiée est largement macroéconomique et centrée sur un objectif chiffré, hautement discutable.
Les primaires avaient pourtant eu le grand mérite, durant quelques semaines, de faire entendre des voix différentes, originales et souvent intéressantes, mettant davantage l’accent sur la qualité de vie ou la préservation des équilibres écologiques. Voix toutefois bien moins audibles aujourd’hui…
Une remise en cause pourtant ancienne, mais souvent oubliée
De nombreux économistes s’élèvent régulièrement contre la recherche (trop) exclusive de la croissance. Le baromètre que constitue l’indicateur de mesure de l’évolution du PIB sur une année est souvent visé par les critiques. Point n’est besoin ici de revenir sur les effets de la prise en compte d’activités qui, bien que générant des revenus aux entreprises qui les exercent, n’apportent aucune valeur à la société (valorisation des activités contribuant à polluer et des activités de dépollution, donc double comptage d’activités qui, au final, n’apportent pas de valeur, pour ne citer que cet exemple).
Au-delà de l’outil de mesure, une remise en cause plus fondamentale de la recherche de la croissance n’a pas attendu ces derniers mois pour se faire entendre. Le rapport Meadows, datant de 1972, alertait déjà de façon très documentée, sur les limites de la croissance, à une époque où ces dernières semblaient pourtant plus lointaines qu’aujourd’hui, en dépit d’un progrès technique souffrant lui aussi de limites. Encore plus tôt, John Stuart Mill, auteur trop souvent oublié bien qu’il fût l’un des penseurs libéraux les plus influents du XIXe siècle, avait largement théorisé sur l’« état stationnaire », conséquence positive à ses yeux de la saturation des formes de croissance matérielle. Conséquence positive au regard des autres formes de progrès qu’elle était susceptible d’encourager, notamment sur le plan moral et spirituel.
Au-delà des remises en cause idéologiques, force est de constater que la croissance, telle qu’elle est mesurée aujourd’hui, est vouée à tendre vers zéro. Dans un précédent article, j’évoquais l’« économie du triple zéro » comme une réalité déjà largement observable, tout en y associant de nouvelles formes de progrès bienvenues.
Voir la croissance comme un moyen
Suscitant de réelles craintes sur les plans politique et géopolitique, l’élection de Donald Trump a également généré de nombreux espoirs sur le plan économique. La politique conduite outre-Atlantique apparaît en effet propre à relancer l’économie et à doper la croissance à court terme, les dangers à plus long terme étant majoritairement sous-estimés.
Montrant que « c’est possible », la politique américaine renforce les attentes et les engagements en faveur de la croissance en Europe et en France. Il me semble pourtant qu’au-delà des chiffres, et il est sans doute raisonnable de ne pas les espérer trop élevés pour des raisons avant tout environnementales, l’important réside dans la qualité de la croissance. Le contenu en emploi de la croissance et le contenu en mieux-être des emplois sont, de ce point de vue, bien trop ignorés et absents des débats.
Nombreux sont pourtant les exemples de pays affichant des taux de croissance élevés sans réduire le chômage (et l’inverse est vrai également). Le plein-emploi n’est pas non plus le garant d’un supplément de bonheur (terme étrangement absent de la campagne en dépit du fait qu’il concerne tout le monde et que le Bonheur national brut soit désormais mesuré dans plusieurs pays). Cumuler deux ou trois jobs devient de plus en plus courant, dans de nombreux pays, avec des effets évidemment délétères sur la qualité de vie.
En parallèle aux considérations sociales envisagées ci-dessus, les impacts environnementaux de la croissance mériteraient d’être également mieux appréhendés et pris en compte. Ils le pourraient au travers d’indicateurs à opérationnaliser tels que le contenu en préservation de la biodiversité ou en stabilisation du climat de la croissance. L’intérêt de tels indicateurs serait de permettre de tenir compte des modalités de la croissance et de leurs impacts avant même la définition d’un objectif de croissance potentiellement néfaste aux vraies ambitions qui doivent être celles des décideurs.
Les objectifs purement quantitatifs demeurent sans doute utiles mais les observer sans porter attention à leurs compléments plus qualitatifs est toujours dangereux. Ce qui est vrai lorsque l’on préside aux destinées d’un pays l’est également lorsque l’on préside à celles de n’importe quelle entreprise ou organisation.
Hugues Poissonnier, Professeur d'économie et de management, Directeur de la Recherche de l’IRIMA, Grenoble École de Management (GEM)
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.