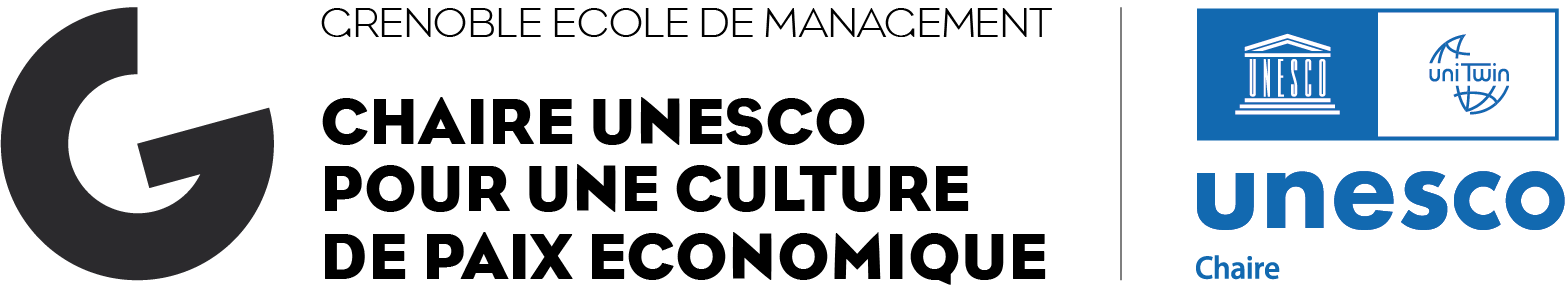Les politiques d’attractivité d’une ville ou d’un territoire se fondent essentiellement sur des critères de performances économiques qui éclipsent les facteurs humains et environnementaux.

Fiona Ottaviani, Grenoble École de Management (GEM)
L’attractivité, telle que le concept est actuellement compris, reflète mal la capacité à donner à chacun la possibilité de bien vivre dans une ville ou sur un territoire. La plupart du temps, l’attractivité est vue au travers du prisme de l’économie dans son sens le plus frustre.
En guise d’illustration, les centres de services d’action régionale, qui fournissent des mesures d’attractivité, ont tendance à se concentrer davantage sur l’offre que sur les besoins des populations. Les enquêtes déclaratives – comme celle dédiée à la construction de l’indice d’attractivité des territoires – ciblent généralement les cadres, les entrepreneurs ou les investisseurs industriels. Les indicateurs d’attractivité sont ainsi alignés sur une certaine idée de croissance économique qui valorise le nombre d’implantations d’entreprises ou encore les créations d’emplois. On va donc considérer qu’un territoire se porte bien à partir du moment où il est capable d’attirer et de retenir un certain nombre de capitaux ou certaines populations.
Les politiques d’attractivité présentent en outre un objectif de croissance démographique, comme en rend compte le professeur d’urbanisme Gabor Zovanyi dans son ouvrage critique The No-Growth Imperative. Mais pas n’importe quelle croissance démographique : dans la lignée de travaux de Richard Florida, les résidents des territoires ne sont considérés comme une source potentielle de création de richesse qu’à partir du moment où ils sont actifs et éduqués. La vision néolibérale de la ville conduit, comme le résume le professeur Guy Baeten, à définir, « tout et tout le monde soit comme gain économique, soit comme perte ».
Ne pas se retrouver « hors jeu »
Pourquoi s’inquiéter de cette prédominance du critère de performance économique ? On pourrait souligner que l’attractivité n’est pas le seul aspect pris en compte dans les politiques territoriales. Ce qui est vrai. Mais on peut s’inquiéter des conséquences du positionnement des villes sur le terrain de la concurrence mondiale. Ce souci de l’attractivité, associé au benchmarking territorial, induit le renforcement d’une hiérarchie des priorités en faveur de l’économique, une adaptation des normes, des systèmes d’information, des connaissances, et surtout de l’allocation des fonds qui répondent à la nécessité de ne pas se retrouver « hors jeu ». Il faut dès lors suivre. Et se forger une image de marque.
Ce faisant, on s’éloigne pourtant de la conception d’une ville ou d’un territoire souhaitable où tous les habitants se sentent bien et pourraient se réaliser. C’est ce constat-là qui nous amène à nous poser la question des indicateurs alternatifs.
Il y a urgence à changer notre conception de la ville souhaitable. La transformation de l’observation sociale et de l’évaluation constitue des jalons d’une telle transition. Un changement majeur dans un contexte où la donnée occupe toujours plus de place dans une action publique qui se complexifie et se contractualise, voire se technocratise… L’avènement des smarts cities accentue cette tendance à la technocratisation, avec la montée en puissance d’une gouvernementalité algorithmique.
Besoin d’une vision plus transversale
Les indicateurs alternatifs (de bien-être, de soutenabilité, etc.) constituent un des outils pour s’extraire du monopole radicale de cet gouvernementalité néolibérale. Ils s’inscrivent dans un mouvement plus large de réintroduction de l’éthique, du politique, et de l’anthropologique pour concevoir l’activité économique. Ils visent à redonner prise aux acteurs sur ces outils statistiques, dont le fonctionnement devient de plus en plus opaque avec la massification des données. Dès lors, si les indicateurs alternatifs peuvent servir à éclairer des zones d’ombre de l’observation territoriale, ils peuvent surtout participer de la construction d’une autre vision du monde commun.
Cette vision, plus transversale, se fonde sur une conception holistique de la nature et de l’être humain, sur la prise en compte de la complexité des formes de réponses aux besoins et sur une autre conception du rapport au temps et aux autres. Une ville n’est alors pas intelligente sans raison humaine : raison de vivre, raison d’espérer, raison en action. En témoigne l’importance accordée aux sociabilités, au temps, au vivre ensemble, à la coopération ou encore au temps dans les expériences participatives sur les indicateurs alternatifs (Pays de la Loire, Grenoble, etc.). Comme en témoigne l’engouement autour du forum international pour le bien vivre à Grenoble, la ville qui attire (au sens de celle à laquelle on aspire) est alors une ville à la mesure de l’humain. Mais quelle « mesure » ? La mesure des seuils écologiques et sociaux qui repose par une prise en compte des interdépendances (sur le territoire et entre territoires).
Cette approche alternative de la ville souhaitable nous permet même de repenser l’étymologie du mot attractivité. En latin, ad et trahere traduit l’idée de « tirer à soi ». Mais ad signifie aussi « en direction de ». On pourrait donc penser à une attractivité davantage « en direction » du futur et des autres territoires. Pour faire « ad-venir » un avenir commun.![]()
Fiona Ottaviani, Enseignante-chercheuse en économie - Grenoble Ecole de Management - Univ Grenoble Alpes ComUE - Chaire Mindfulness, Bien-être au travail et Paix économique - Chercheuse associée au CREG - Université Grenoble Alpes, Grenoble École de Management (GEM)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.